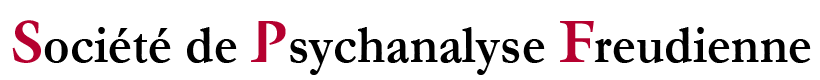Samedi 13 juin 2026
A l’Association de Quartier Notre-Dame des Champs
92 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
Le programme sera communiqué ultérieurement sur le site internet de la SPF et via des mailings d’annonces
Les études de Gisela Pankow, née en 1914, furent bien sûr compliquées par la guerre. Licence de mathématiques, de physique…emploi de statisticienne dans l’industrie, secteur de la recherche à Hambourg puis à Tübingen, où elle s’installe en 1943 après la mort suspecte de son père. Elle s’inscrit à la faculté de médecine et démarre une psychanalyse qui durera, avec un changement d’analyste jusqu’en juillet 1947. Docteur en mèdecine en 1949 après sa thèse « Recherche sur la coudure des os et la base du crane chez l’homme ». Elle devient assistante de recherches et résidente de l’hôpital psychiatrique dirigé par Kretschmer.
Après Kretschmer et ses deux types de psychose (psychose marginale et psychose nucléaire) Pankow, à Tubingen, a rencontré Romano Guardini et son oeuvre, celle de Urs von Balthasar, et aussi Gustav Siewerth et ses écrits. Ils sont très impliqués dans la foi catholique, « proches » de Thomas d’Aquin et aussi… de la pensée heideggérienne…
1950 : premier colloque de psychiatrie à Paris où elle s’installe et travaille dans le service d’endocrinologie de Jacques Decourt. Dès 1953 elle reçoit des malades psychotiques, entre en contact avec la SFP où elle rencontre Jacques Schotte et fait des contrôles avec Dolto, Lacan, Lagache. Puis voyage aux États-Unis où elle fait la connaissance de Frieda Fromm-Reichmann et de Sullivan, importants pour le travail en milieu hospitalier, Chesnut lodge, que la clinique de La Borde lui évoquera plus tard.
Tous ces éléments biographiques variés, toutes ces rencontres serviront pour comprendre les engagements très personnels de Pankow dans la conception de la psychothérapie des psychotiques. Elle reconnaît l’importance fondamentale de Freud mais aussi ses limites par rapport à la psychose. Elle s’intéresse beaucoup à l’art : sculpture, peinture, littérature, cinéma dont elle se servira dans son travail…
Dès 1956 elle publie des études de cas dans lesquelles elle utilise les « fonctions symbolisantes de l’image du corps », la première à propos de la forme (atteinte dans la schizophrénie), la deuxième qui concerne le contenu et le sens (atteinte dans les délires non schizophréniques…)
Il faudra aussi parler de l’utilisation du modelage, du mode d’intervention qui n’est pas une interprétation, du rapport avec la famille et les équipes soignantes…
Comité d’organisation
Christian CHAPUT, Dominique DUCARD, Brigitte MAUGENDRE